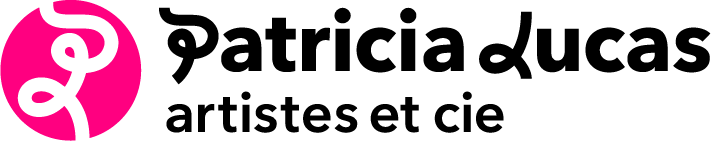Comment en es-tu arrivé là aujourd’hui ?
L.S. : J’ai découvert le dessin par la BD franco-belge quand j’étais môme. Je possédais peu d’albums mais j’en empruntais beaucoup à la bibliothèque de ma petite ville. Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Asterix… C’était une bonne école visuelle.
Je ne baignais pas spécialement dans un environnement artistique mais je dessinais beaucoup, sans doute parce que cela me permettait de me fabriquer une bulle d’intimité.
J’ai eu la chance de rentrer à l’École des Beaux-Arts d’Orléans, et d’y rencontrer des personnes formidables, élèves ou profs. On y cultivait quelque chose de touche-à-tout, non restrictif, de l’illustration à l’animation, en passant par le collage, l’affiche, le monotype, l’eau forte, mais aussi le numérique, qui arrivait.
J’ai eu la chance d’y avoir de bons guides, qui m’ont surtout appris à développer questionnement et exigence. J’y suis entré sans savoir ce qu’on pouvait faire de sa vie avec le dessin, mis à part de la BD. J’en suis sorti en me disant qu’illustrateur, ouais, tiens, ce n’était pas une si mauvaise option ! J’avais toujours autant envie de dessiner et ce métier me permettait de le faire autant que je voulais.
Quelle est ta technique de prédilection ? Comment travailles-tu ? Est-ce que tu pars d’un croquis dessiné à la main et finalisé en numérique, par exemple ?
Au début de mon activité, j’ai travaillé pendant quelques années entièrement en numérique. Je n’utilisais plus de matériel traditionnel : juste un stylo pour des roughs ou des croquis. J’ai replongé dans l’encre lorsque je me suis mis à faire de la BD.
Aujourd’hui, je travaille principalement sur papier pour le trait. C’est plus rapide et intuitif que sur tablette graphique. Je n’ai pas la tentation du Pomme-Z sans fin. Si je rate, je recommence : c’est tout et ce n’est pas grave. Quand je dessine pour la presse, il m’arrive de faire des images entièrement en traditionnel, à l’encre et aux crayons de couleur. Mais en général, je préfère travailler mes couleurs sur ordi, et j’aime toujours autant faire des images purement numériques. Je ne trouve pas gênant le fait de passer de l’un à l’autre. Je suis assez versatile…

Quels sont les sujets ou les supports qui t’intéressent le plus ?
Oh ! Les sujets de société particulièrement. On vit une époque difficile et passionnante… Je crois que notre métier arrive au bout de ce qu’ont initié les Mad Men des années 50. Trouver du sens à ce que l’on fait devient un marqueur important pour beaucoup de gens. Notre métier d’illustrateur.trice n’échappe pas à cette tendance.
Après, j’ai des « motifs » graphiques de prédilection. En particulier, j’aime bien produire des images épiques. Je crois que j’ai été formé « visuellement » par le cinéma de Kurosawa. J’aime dessiner ce qui bouge, l’impermanence : que ce soit les vagues ou les gens qui dansent. J’aime dessiner les visages, ce qui les traverse.
Quant aux supports, j’apprécie particulièrement celui de l’affiche, il y a quelques chose d’étonnant, bien sûr, à voir ses images en grand format dans une ville. Et pour le pratiquer parfois de manière sauvage, je trouve que c’est un support charmant…
Où trouves-tu ton inspiration ? Y a-t-il un artiste en particulier qui t’a le plus inspiré dans ton travail ?
J’évoquais Kurosawa, mais je n’ai pas d’artiste « source ». Je me sens tout autant concerné et ému par les constructivistes russes que par la peinture sumi-e. Je crois être très inspiré par Yoshitoshi, dessinateur japonais du XIXe siècle, qui a introduit des couleurs totalement folles dans ses estampes.
J’aime l’art de la synthèse de Savignac, le trait de Ralph Steadman, la majesté des peintures de Séraphine de Senlis. En BD j’ai une profonde passion pour le travail de Jim Woodring, j’adore toutes les périodes du travail de Florence Dupré La Tour, et je trouve aussi les chemins graphiques pris par Catherine Meurisse totalement formidables.
Je ne crois pas que ces gens soient des inspirations à proprement parler, car certain.e.s sont somme tout assez éloigné.e.s de ce que je fais. Ca me fait écho, voilà.

Si tu devais retenir une expérience qui t’a marqué en tant qu’illustrateur, ce serait quoi ?
On est souvent confronté à une contradiction : on fait ce métier d’abord pour soi, parce qu’on aime dessiner, tout simplement. Mais dès lors qu’on vend sa production, il faut accepter de perdre la main dessus. Et parfois, ça peut aller loin. C’est toujours très troublant de voir un argumentaire marketing plaqué sur ses images pour convaincre le client que c’est la bonne patte graphique, que toutes les raisons sont là pour foncer. À chaque fois, j’ai le sentiment qu’on accorde une place déraisonnable à la raison au détriment du ressenti. Je ne raconterai pas d’anecdote particulière à ce sujet mais c’est quelque chose que je ressens régulièrement. À l’inverse, une des choses les plus agréables à vivre est de voir des gens s’arrêter devant une image qu’on a réalisé. Une couverture, une affiche, un dessin… Saisir ce moment où des gens se sentent interpellés, c’est vraiment formidable !

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ?
Je ne sais pas… Peut-être la position assise ? En fait, je constate que la majorité des gens travaille dans des conditions difficiles en terme de rythme, de cadence, souvent en position debout, à piétiner sur place, sans jamais pouvoir penser à des choses à soi….
L’illustration est un travail qui permet d’échapper à l’aliénation, c’est plutôt cool. C’est aussi un métier qui donne la possibilité de sans cesse progresser. Ce qui n’est pas toujours facile à mettre en pratique !
Sur un tout autre registre, ce qui me plaît dans mon travail, ce sont vraiment les interactions qui résultent du fait qu’on produit et qu’on montre des images…
Quelle serait ta devise ? Y a-t-il une phrase qui te représente le plus ?
En fait, je n’arrive pas trop à me cerner. Ou plutôt, je n’ai pas envie de me cerner. En cours de dessin, aux Beaux-Arts, on nous répéter toujours qu’il fallait se méfier du cerne… parce qu’il a tendance à étouffer la vie du dessin !
Propos recueillis par Valentine Thomasset-Schanke